
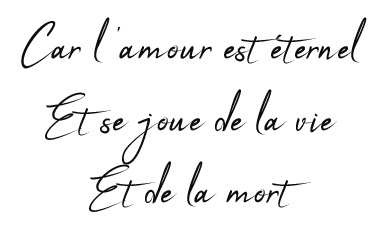
La maison, construite en 1895 m’avait-on dit, se tenait comme figée, face à moi. Sa toiture avait été restaurée avec le temps mais sa façade aux pierres d’origine ou si peu remplacées, lézardée par endroit, ses volets en bois d’un bleu azur écaillé semblaient me chuchoter des secrets enfouis depuis longtemps.
L’homme aux cheveux grisonnants qui m’avait conduite jusqu’ici sortit un trousseau de clés, en sélectionna une puis la tourna et la retourna dans la serrure avec insistance. Enfin, avec un regard triomphant, il poussa la porte et se plaça sur le côté pour me laisser entrer.
Ce moment, je l’avais attendu avec impatience et pourtant j’hésitai, immobile sur son seuil qui s’ouvrait telle une gueule béante et noire et qui semblait à cet instant vouloir m’absorber, ou m’abriter des longs gémissements du souffle qui emportait mes cheveux, sans que je sache réellement si les plaintes lugubres étaient émises par le vent ou par l’âme de la maison.
Les propriétaires n’y habitaient plus depuis plus de trois ans. Ils avaient préféré rejoindre le continent, plus rassurant parait-il.
Plusieurs occupants, originaires d’ici ou d’ailleurs, s’y étaient succédé, sans jamais rester très longtemps. D’après l’agence immobilière en charge de la vente, tous avaient fini par renoncer. On m’avait parlé, sans s’étendre, de contraintes familiales ou professionnelles, ou de vagues raisons d’incompatibilité ne permettant finalement plus de vivre là.
Il est vrai que l’endroit, esseulé, situé sur une sorte de no man’s land balayé par tous les vents, hiver comme été avec encore plus de force du fait de son exposition particulière, avait de quoi laisser songeur.
Je m’étais surprise à penser que peu m’importait tant je sentais que cette maison serait bientôt à moi, qu’il ne pouvait en être autrement.
Lorsque je l’avais repérée depuis Paris, dans les annonces répertoriant les biens disponibles dans cette région, elle m’avait tout de suite attirée. Et le nom de « Ouessant », où elle se situait plus précisément, sonnait agréablement à mes oreilles, résonnait même au-delà, dans un recoin inaccessible à toute explication rationnelle.
On m’avait fortement déconseillé une telle initiative, tenté de me mettre en garde contre la rudesse du climat l’hiver et puis la solitude des lieux qui ne manqueraient pas de me faire regretter un tel choix.
Mais était-ce réellement un choix ?
Depuis toujours me semblait-il, était enfoui en moi, très loin de la raison et des logiques interprétations, un amas de doutes m’empêchant d’être tout à fait présente, où que je sois. J’avais envie de tout et de rien à la fois. Le simple fait de devoir prendre une décision m’avait toujours paru insurmontable. Je ne savais pas, je ne savais plus si les options s’ouvrant à moi étaient au fond les bonnes. J’oscillais devant l’ouverture de possibles qui finalement bien souvent m’échappaient. Déroutée par ce tumulte intérieur, j’avais fini par m’en remettre totalement aux hasards de la vie, leur laissant le soin de me conduire, de préférence du mieux possible et sans trop de heurts.
Cette fois encore, il me semblait que ce n’était guère différent. Je n’étais à nouveau qu’un instrument, dont je ne maitrisais pas la portée et je n’avais fait autre chose que suivre son mouvement.
De toute façon, rien ne me retenait à Paris. Ni ailleurs. Rien ne m’avait jamais retenue nulle part.
A trente-neuf ans tout justes passés, je vivais seule. J’avais bien eu quelques aventures, sans grande passion pour ma part, qui s’étaient toutes terminées par des fiascos. J’en portais certainement la responsabilité ; au fond, j’étais peut-être trop exigeante (ou pas assez) et puis qu’attendais-je vraiment de l’amour ? Qu’il m’emporte ou me révèle à moi-même ? Non, l’amour véritable, celui qui s’écrivait avec un grand A, n’existait pas. Ou alors, je n’étais tout simplement pas faite pour la vie à deux.
Côté travail, j’avais déjà accumulé un nombre impressionnant de postes dans lesquels je n’étais jamais restée très longtemps, ne m’y sentant pas non plus à ma place. Et puis d’ailleurs, dans le dernier en date,
j’arrivais au bout de mon envie de m’y accrocher. Il était temps pour moi de passer à autre chose.
Au-delà de toutes ces tentatives qui avortaient d’elles-mêmes, ce qui exaspérait, ce qui désespérait surtout mes proches pourtant habitués à mon caractère indécis était de constater que je ne ressentais absolument aucun besoin de comprendre le pourquoi de tous ces échecs à répétition. On me demandait parfois (on se le demandait à soi surtout) où tout cela me mènerait.
Avec le recul, je dirais qu’au fond, inéluctablement, j’allais là où je devais être.
L’agence immobilière contactée par téléphone m’avait vanté la beauté de l’île et le charme de la maison. Je m’étais laissée gagner par leur enthousiasme. Conquise et étrangement portée par l’idée d’aller voir outre-terre, de traverser la mer d’Iroise dont le nom seul m’évoquait des promesses, je m’étais penchée sur les aspects pratiques.
Je n’aurais aucun mal à vendre la maison dans laquelle je vivais et dont, fille unique, j’avais hérité à la mort de ma mère, survenue deux ans à peine après celle de mon père. Ma chambre était restée telle qu’elle était à mon adolescence. Je m’étais soudain revue, plongée dans les longues rêveries où j’aimais alors me laisser aller. Jusqu’au moment où, sous l’appel insistant de ma mère me demandant pour la énième fois de venir manger, de penser à faire mes devoirs, ou de me dépêcher de me préparer pour aller au lycée, il me fallait à contrecœur revenir dans la réalité si vide de certitudes qui m’auraient réconciliée à la vie. « Lorène… ! » l’entendais-je régulièrement crier du fin fond de la maison.
Lorène. Même ce prénom, j’avais du mal à m’y faire. Je ne m’y retrouvais pas, pas complètement.
Je réalisais qu’aucune tristesse ne m’habitait à l’idée de quitter ce lieu qui m’avait pourtant choyée depuis ma naissance. Un peu de nostalgie peut-être. Et encore. Avec un fond de culpabilité, je constatais une fois de plus que je n’avais pas réussi à m’attacher à cette vie-là.
Située dans les quartiers chics de Paris, j’étais en tout cas assurée d’en tirer bien plus que le prix de la maison d’Ouessant. Cela me permettrait de profiter d’une nouvelle liberté tout en continuant de faire confiance au hasard, décidément mon seul et véritable compagnon de route.
Autour de moi, on s’inquiétait, on s’étonnait beaucoup de me voir soudain aussi tenace sur un tel projet. Aussi, la visite sur l’île approchant à grands pas, dès que l’occasion se présentait, ma famille proche, les quelques amis gardés de mes années de lycée que je voyais de temps à autre, qui calmaient un moment mes doutes, un moment seulement avant que je ne retombe dans ce vague à l’âme qui voilait ma vie, tentaient de me ramener à la raison, me pressaient de questions sur ce départ insensé qui assurément, je le lisais dans leurs yeux, je l’entendais dans leurs voix, serait la plus grosse erreur de ma vie.
Mais tout ceci, ma maison actuelle, mon travail, les craintes et les conseils ne me semblaient pas importants. Ce qui l’était beaucoup plus, en revanche, était cette curieuse, impérieuse et inexplicable nécessité d’aller là-bas.
Depuis que j’avais vu les photos de la maison, pour une raison totalement obscure, j’avais un besoin absurde et imminent de bords de mer, d’étendues de sable soulevé par les vents, de parfums puissants et salés, d’embruns furieux et, au milieu de tout ça, de longs cris de goélands.
Personne ne croyait une seconde en ces besoins-là. On préférait mettre en avant tout ce que j’avais alors, et que je n’aurais plus.
*
La maison était posée sur une parcelle de terrain isolée au nord-ouest de l’île. Comme je l’avais entraperçu sur les photos de l’annonce, la façade donnait sur un jardin clôturé. Celui-ci était fermé par un portail en fer, qui grinça quand on l’ouvrit. Au-delà, sur une lande dénudée d’arbres se déroulait, entrecoupé de roches, un tapis moussu, fleuri d’ajoncs, de giroflées bleues, bientôt aussi d’agapanthes et de bruyères m’avait assuré l’agent immobilier. La façade ouest offrait une vue extraordinaire sur la mer qui s’agitait furieusement à quelques mètres à peine, pour se fondre tout au loin dans l’étendue grisâtre du ciel.
Sous le regard intrigué de l’homme planté à mes côtés alors que, toujours sur le seuil de la maison, je remontais en pensée tout le déroulement qui m’avait conduite jusqu’ici, je me décidai enfin à faire les quelques pas qui me séparait de la demeure et entrai.
La lumière faible du dehors parvenait à peine à se faufiler au travers des fenêtres. Nos pas résonnèrent sur les dalles de pierre brute, réveillant des échos depuis longtemps endormis. Les portes émirent en s’ouvrant un interminable grincement, elles semblaient, elles aussi, s’éveiller d’une longue torpeur. Tous ces bruits insufflèrent en moi un étrange sentiment. Je détaillai le plafond, traversé de poutres de chêne, et la grande cheminée, qui apportaient un charme certain à l’ensemble. Quelques marches de bois montaient pour conduire à l’étage supérieur ; là-haut, se trouvaient selon l’annonce deux chambres et une salle de bains. Dans la cuisine dans laquelle nous pénétrâmes, trônait une table lourde en bois massif laissée par les propriétaires, tout comme, vestige muet, une panoplie de casseroles en cuivre suspendues au mur.
Sans l’avoir imaginée jusqu’à cet instant, la maison était exactement telle que je la souhaitais. C’était une bâtisse solide, rugueuse, conforme à l’architecture des maisons construites sur cette île.
La seule particularité était le piano. Un piano droit. Couvert d’un épais voile de poussière, il s’appuyait tout au fond de la pièce principale, contre le mur de l’escalier.
L’homme qui me guidait dans la visite suivit mon regard.
− Le piano fait partie de la maison, dit-il, vous pourrez le garder ou bien le vendre, cela ne pose aucun problème. Dans le grenier, il y a tout un tas de bric-à-brac, des objets, quelques meubles aussi. Ça fait un bail que c’est là-dedans. En tout cas, ça l’était déjà quand l’agence s’est installée sur l’île il y a maintenant plus de trente ans, c’est vous dire. Je le sais parce que c’est moi qui ai toujours été en charge de la vente de cette maison. D’ailleurs, c’est curieux, à chaque fois les acheteurs sont intéressés pour les garder et à chaque départ, rien ne semble avoir été dérangé. Du coup, on a pris l’habitude de les laisser. Si ça peut servir. L’ancien revient à la mode actuellement. Le vintage, comme on dit. Mais nous pouvons faire le nécessaire pour tout vider avant votre installation. Il faudra nous le confirmer. Ça vaut aussi pour le piano.
*
Je pris possession de la maison fin septembre. Le temps de faire les papiers, de signer les actes, de me débarrasser de ma vie d’avant, le printemps et l’été en avaient profité pour filer, laissant place aux premiers jours d’un automne nuageux.
Les premières semaines, plongée dans les travaux de rafraichissement des sols, des murs et des plafonds et par la remise en état des objets et meubles du grenier que j’avais décidé de conserver, cela m’éviterait le déménagement fastidieux d’une bonne partie de ceux de mon appartement que j’avais fait porter dans un garde-meuble en attendant de décider de leur sort, je me coulai chaque nuit dans un sommeil épuisé.
Puis tout fut enfin terminé et je pus contempler, satisfaite, l’intérieur de ma nouvelle maison. Il me semblait lui avoir redonné vie. Le grenier s’était révélé une mine de trouvailles. Curieusement en effet, comme l’avait souligné l’agent immobilier, personne ne s’y était visiblement intéressé. Je m’en étais félicitée tout en fourrageant avec bonheur dans les caisses fermées et empilées dans les recoins poussiéreux. J’avais ainsi trouvé, entassés pêle-mêle, une lampe à huile en cuivre, deux bougeoirs à anse en laiton, un joli porte-manteau en fer et bois, une horloge murale, un grand miroir entouré de frises sculptées du plus bel effet, des peintures d’artistes inconnus ainsi qu’un service, incomplet et quelque peu ébréché mais non dénué d’intérêt, de vaisselles de porcelaine. Une malle renfermait en outre de magnifiques objets marins : une longue vue, ce qui s’apparentait à un sextant, une grosse boussole et divers accessoires que je ne connaissais pas. Et, tapi tout au fond de la malle, entouré comme une relique d’un morceau de tissu, il y avait également un vieux manuel de solfège aux pages jaunies, écornées, effritées pour la plupart. Sur la couverture, presque effacée, une année : 1935. Je m’étais étonnée de cette dernière trouvaille. Cela voulait-il dire que ces objets étaient là depuis tout ce temps, que personne à part moi n’était venu fouiller dans ce grenier ? J’en doutai. Cela m’avait néanmoins troublée.
Je m’étais attelée à briquer et à restaurer le tout avec une joie sereine à l’idée d’utiliser ces objets imprégnés de passé. J’avais mis aussi la main sur des objets plus volumineux qu’il m’avait fallu rafraîchir : un guéridon, une commode à tiroirs, les panneaux démontés d’un lit et d’une armoire ainsi qu’une table, des chaises, deux larges fauteuils au revêtement fané que j’avais changé en trouvant, par miracle sur internet, un tissu aux motifs presque similaires. J’avais disposé le tout à l’intérieur de la maison, tentant de trouver l’emplacement idéal, déplaçant puis replaçant les meubles, les objets, jusqu’à ce qu’une certitude venue de nulle part me fasse stopper le mouvement. Ici. C’était ici et pas ailleurs.
J’avais donc terminé mon emménagement dans un sentiment de profonde satisfaction. Au final, il me semblait que tout était parfaitement disposé et qu’il ne pouvait en être autrement.
Il me fallait à présent baptiser ma maison. Un nom me vint aussitôt à l’esprit. L’Agapanthe. La maison s’appellerait l’Agapanthe, au regard de ces jolies fleurs qui couvraient la lande tout autour et dont j’avais pu admirer les grands tapis bleutés lors des allers-retours effectués durant les beaux jours. Je ferai graver ce nom sur une plaque de faïence que je fixerai au-dessus de la porte d’entrée à la place de l’ancienne, devenue illisible avec le temps. Pour fêter ça, j’ouvris une bouteille puis, le verre à la main, balayai la pièce du regard, pas loin de me sentir comblée.
Presque.
C’est la nuit suivante qu’un bruit étrange se faufila dans mon sommeil, me sortant à peine de ma torpeur. Le son, cristallin, ressemblait à des notes de musique.
J’entrouvris les yeux, à la frontière du sommeil et de l’éveil, là où flottent parfois les rêves qui semblent si réels. Dans cet état à demi conscient, j’entendis quelqu’un jouer un air très doux. Mon esprit embrumé suivit son lent déroulement. Puis la musique se tut. Quelques secondes après, je me rendormis.
Le lendemain matin, après le petit déjeuner, je décidai d’aller me promener le long de la mer. Je n’en avais pas vraiment eu le temps depuis mon arrivée, m’étant focalisée sur les travaux de rénovation et d’agencement de la maison, repoussant à plus tard la découverte de l’île. Au travers des vitres de la fenêtre, le ciel était gris avec cependant çà et là des petites plages de bleu. J’hésitai un moment. Les nuages galopaient plutôt vite dans le ciel et ne faisaient probablement que passer. D’ici une heure, le ciel serait à coup sûr dégagé.
Je sortis donc, confiante, et pris le petit sentier sinueux qui menait à la côte et la longeait.
Au bout de quinze minutes d’une marche enthousiaste, le ciel tomba d’un coup. Le vent se mit à siffler, puis à pousser des hurlements sinistres, pliant sous la brusquerie de ses rafales les bouquets touffus d’herbes agrippés aux dunes de sable dont les minuscules grains vinrent gifler mon visage. Les nuages sombres défilaient à n’en plus finir dans un ciel à portée de main. Les vagues furibondes semblaient jeter leur désespérance sur les rochers, éclaboussant furieusement le sentier que j’avais emprunté. Les cheveux plaqués sur mon visage par les embruns féroces, je dus me rendre à l’évidence et fis demi-tour pour finir ma promenade au pas de course, la tempête ayant décidé de s’acharner avec encore plus de virulence.
Après avoir vérifié que les volets étaient solidement arrimés aux murs, je me calfeutrai à l’intérieur de la maison. Les interrupteurs ne répondirent pas. Il n’y avait plus de courant. La foudre avait dû tomber sur un plot ou s’était abattue sur des fils électriques, probablement qu’il me faudrait attendre un bon moment avant que tout ne rentre dans l’ordre.
Heureusement, j’avais quelques bougies rapportées dans mes bagages parisiens. J’en fixai dans les deux bougeoirs en laiton, en déposai un sur le haut du piano, l’autre sur la table, allumai également la mèche de la vieille lampe à huile. Puis, n’ayant d’autres choix que d’attendre l’accalmie, je mis une bouilloire sur le feu pour me préparer une infusion. Je prendrai un livre ou j’écouterai les rugissements du vent tout autour de la maison. C’était ma première expérience en ce domaine. L’idée me traversa que j’aurais dû ressentir de la peur à me retrouver ainsi dans une maison isolée, posée sur une terre en plein milieu d’un océan déchainé mais, curieusement, je me sentais comme protégée. Je frissonnai, certes, mais ce n’était pas de peur.
A l’extérieur, le vent allait toujours aussi fort. Il secouait les volets qui tremblaient contre les murs. Mes pas incertains me menèrent vers la commode, là où j’avais rangé le manuel de partitions trouvé dans le grenier. Pensive, je le sortis pour ensuite m’installer confortablement dans un des fauteuils récupérés du grenier. Ma main, songeuse, caressa un moment la couverture cartonnée avant de la soulever, et de tourner lentement les feuillets couverts de notes de musique, tandis que la symphonie furieuse du dehors jouait de plus belle sa propre partition.
Le soir même, le rêve fit à nouveau son apparition. Il s’insinua, avec la même tonalité que la nuit précédente pour disparaître au moment où mon esprit commençait à sortir de sa torpeur.
Au petit matin, je décidai d’aller faire un tour à la bibliothèque. C’était certainement le meilleur endroit qui m’aiderait à mieux connaître l’île. Il devait forcément y avoir des ouvrages sur la question. Et puis, peut-être y trouverais-je aussi, pourquoi pas, quelques anecdotes sur les habitations, la mienne par exemple.
La bibliothèque était minuscule, deux uniques pièces, dont l’une consacrée à la catégorie jeunesse. Certes, nous n’étions pas à Paris, je ne m’attendais pas à quelque chose de spacieux, mais cela me désorienta pourtant quelque peu. Une personne s’y trouvait qui me salua lorsque j’entrai, et qui se mit à rire à la vue de ma mine déconfite. Elle se présenta comme étant la responsable du lieu. Nous fîmes à vrai dire vite connaissance. La cinquantaine vive et pimpante, Sandra travaillait ici depuis plus de vingt ans. Passionnée de mots et d’histoires en tous genres, elle m’avoua avoir eu l’opportunité d’aller travailler dans des endroits plus grands sur le continent mais jamais elle n’avait accepté de partir. Elle tenait trop à son île. Sandra était si spontanée, si chaleureuse que je n’eus aucune peine à me laisser aller. Je me sentais bien ici. La pièce dédiée aux livres jeunesse, dont l’un des murs était percé d’un grand hublot, me faisait penser à une chambre d’enfant, douce et confortable, invitant à s’évader hors du temps.
Comme il n’y avait personne d’autre, nous nous mîmes à bavarder. La conversation porta vite sur la maison que je venais d’acquérir.
− Elle a une histoire douloureuse, cette maison, m’apprit Sandra. C’est ma grand-mère qui me l’a racontée. Bien qu’elle fût jeune quand cela s’est passé, elle en a gardé, jusqu’à sa mort, un souvenir précis. La maison doit résonner encore de la tragédie qui s’y est déroulée et c’est sûrement pour ça que personne n’y est jamais resté plus de quelques mois, à part les derniers propriétaires, qui n’y vivent plus d’ailleurs. Il doit y avoir comme une malédiction là-dedans… Oups ! dit soudain Sandra portant une main confuse devant sa bouche. Je parle trop, je crois. Vous venez tout juste d’y emménager. J’espère que je ne vous ai pas effrayée. Vous savez, continua-t-elle avec un petit rire léger, sans doute pour adoucir l’aspect sombre de ses mots, les histoires circulent, et les gens sont trop superstitieux.
− Ne vous inquiétez pas, lui assurai-je, moi je ne le suis absolument pas. Et je suis vraiment intéressée de connaître cette histoire.
J’appris ainsi l’existence d’Eléonore. Ce devait être dans les années 1930, Sandra ne se souvenait plus très bien.
− Eléonore avait une dizaine d’années quand sa mère est morte. Un tragique accident. Son père ne s’est jamais remarié, se consacrant au bonheur de sa fille. Hélas, son désir a vite tourné à la possessivité. Surtout qu’Eléonore devenait de plus en plus belle en grandissant. Des yeux bruns, de longs cheveux noirs, une silhouette à faire pâlir d’envie toutes les femmes de l’île… Tu penses, les hommes la convoitaient du regard mais avec le père jamais très loin, impossible d’oser même espérer quoi que ce soit. Eléonore s’est donc vite retrouvée isolée. Son père était, parait-il, devenu intraitable avec le temps. La vie de sa fille était entre ses mains et il comptait bien la modeler à sa façon. D’après ma grand-mère, les rares fois où l’on croisait Eléonore se promenant sur la lande, elle vous souriait doucement mais jamais de ses lèvres ne passait le moindre mot. Elle s’était, à mon avis, complètement coupée d’elle-même. Quelle tristesse il devait y avoir dans cette maison.
Sandra s’arrêta un instant, comme à l’écoute d’une pensée qui venait de la traverser, puis elle releva soudain la tête.
− L’Agapanthe ! C’est son nom ! C’est drôle, je viens de m’en souvenir ! s’exclama-t-elle sans remarquer le regard perplexe que je venais de poser sur elle. En tout cas ce qui est sûr, c’est qu’Eléonore adorait la musique. Elle jouait divinement du piano. La seule distraction que son père lui avait autorisée. Ça le déculpabilisait sans doute et puis ça devait le rassurer de la savoir cloîtrée à l’intérieur de la maison. Il avait accepté qu’elle y donne quelques cours, mais aux enfants de l’île uniquement. Une bouffée d’air sans doute pour Eléonore de pouvoir côtoyer un peu de vie.
Sandra se tut, son regard semblait tourné vers celle qui lui avait raconté, plusieurs fois peut-être, la triste vie d’Eléonore : sa grand-mère. Je m’imaginai entendre sa voix avec en musique de fond les rafales d’un vent puissant.
− Un jour, reprit Sandra, un étranger est arrivé du continent. Il était venu pour aider à la construction du phare Nividic. On devait manquer de bras à l’époque. La plupart des hommes étaient sur les mers, il fallait bien que le travail se fasse. Tu connais ce phare ? demanda Sandra. A ce stade, nous en étions déjà au tutoiement.
Comme je secouais la tête, Sandra m’expliqua qu’il s’agissait de celui qui se trouvait tout à l’ouest de l’île, à la pointe de Pern.
− On ira ensemble, si tu veux, proposa-t-elle, je te raconterai son histoire. Toujours est-il, poursuivit-elle, on ne sait comment, l’étranger rencontra Eléonore et… eh bien, ils tombèrent éperdument amoureux l’un de l’autre. J’ai beaucoup rêvé à cette histoire quand j’étais jeune, c’était tellement romantique.
Sandra s’arrêta un moment, perdue dans son souvenir, puis soudain elle s’anima.
− Selon ma version à moi, il se promenait sur la côte, et puis il entend une musique. Il tourne la tête de tous les côtés (tout en parlant, Sandra s’était mise à mimer théâtralement l’intrigue et je ne pus m’empêcher de rire). Il voit une maison d’où semble s’échapper la mélodie. Il s’en approche, ce jour-là le père d’Eléonore devait être absent. Il entre, aperçoit Eléonore, elle est assise et joue du piano. Alors, sentant une présence, elle tourne la tête, leurs yeux se rencontrent et, boum ! Le coup de foudre ! Est-ce que ce n’est pas exaltant !? s’exclama Sandra le regard brillant de retrouver ses rêves d’adolescente. Mais bon, tu devines la suite.
Oui, je l’imaginais parfaitement. Le père d’Eléonore avait mis un terme définitif à cette relation, impossible pour lui à envisager.
− Son père était notable et il avait le bras long. L’ « intrus » (Sandra avait mimé des guillemets) est définitivement reparti. Quelques semaines plus tard, Eléonore se donnait la mort, Son père est devenu fou de douleur, il a d’ailleurs fini par le devenir complètement. La maison a été vendue quelques mois après sa mort. L’acquéreur a trouvé une partition, cachée dans le piano, écrite de la main même d’Eléonore. Partition qu’il a lui-même joué un jour devant les habitants de l’île. Elle était, aux dires de ma grand-mère, d’une telle douceur, d’une telle tristesse qu’elle n’avait pu être écrite qu’après le départ forcé du grand amour d’Eléonore. Une lettre d’adieu, en somme. Hélas, la partition a été emportée par son propriétaire lorsqu’il a quitté les lieux. Quel dommage, conclut Sandra, j’aurais tellement aimé l’écouter. En tout cas, depuis, cette histoire s’est propagée un peu à la façon d’une légende car, aux dires de certains, par temps de brume, on voit parfois la silhouette d’Eléonore flotter le long des récifs. Mais je te rassure ! affirma-t-elle aussitôt en balayant l’espace d’une main, à présent, tout ça, ce n’est plus que du folklore. Les anciens ici aiment bien jouer avec devant les touristes. Ça attise leur curiosité. D’ailleurs, ne t’étonne pas trop de voir parfois des gens passer devant ta maison. Certains se plaisent à imaginer l’histoire au plus près de l’endroit.
Je me retins de lui dire qu’il me semblait avoir entendu chez moi la nuit dernière le son d’un piano. Mais sans doute commençais-je à m’imprégner un peu trop du drame vécu par cette Eléonore. Je n’étais de toute façon pas portée sur les événements étranges, aussi je m’abstins. Pour moi, tout phénomène avait une explication rationnelle. Et en l’occurrence, elle était simple. J’avais rêvé.
Nous passâmes ainsi l’après-midi, dans une grande complicité, évoquant nos vies respectives et la promesse de nous revoir.
La nuit suivante, au son léger de la musique venue à nouveau s’infiltrer dans mes rêves, je me réveillai cette fois tout à fait pour constater, étonnée, que les notes semblaient provenir d’ailleurs. Elles semblaient traverser les murs.
Intriguée, je repoussai les couvertures et me levai. Malgré le radiateur, la pièce était glaciale. J’attrapai un châle, ouvris la porte de la chambre qui grinça légèrement. Les marches gémirent sous mes pas lorsque je descendis l’escalier.
Parvenue en bas, la musique s’était tue. Seul le silence, lourd, m’accueillit, il me sembla entendre derrière son épaisseur des chuchotements.
Je me secouai et parcourus des yeux la pièce. Il y faisait encore plus froid que dans la chambre. L’âtre de la cheminée exhalait des relents de fumée, bien que le feu fût éteint depuis longtemps. Resserrant le châle autour de mes épaules, j’eus soudain la sensation de quelque chose d’anormal. A l’instant même, je réalisai que la flamme de la bougie, que j’avais posée sur le piano le soir où le courant avait sauté, vacillait, projetant des ombres sur les murs silencieux.
Je n’étais pourtant pas du genre à oublier d’éteindre du feu avant d’aller me coucher. D’ailleurs, en y réfléchissant bien, je n’avais pas le souvenir d’avoir allumée cette bougie la veille, mais l’avant-veille, le courant étant revenu dès le lendemain matin de la tempête. Une sensation de flottement me prit en essayant de me rappeler. Sans succès.
Intriguée, j’allai m’asseoir sur le large tabouret, figé devant le piano. Lorsque, après l’avoir dépoussiéré, j’avais voulu l’encaustiquer, j’étais tombée sur une plaque indiquant un nom : Erard et une date : 1931. Je l’avais fait expertiser par un professionnel de la musique. Celui-ci l’avait inspecté sous tous les angles. Au final, d’après lui, le piano pouvait être à peu près restauré, ce qui était déjà pas mal semblait-il, compte tenu de sa date et des longs mois durant lesquels il avait dû être exposé au froid et à l’humidité. Par contre, il ne fallait pas non plus s’attendre à un son parfait. Mais peut-être cela valait-il le coup d’essayer. Je lui avais donné mon feu vert.
Dans le silence impénétrable et la lueur tremblotante de la flamme, je soulevai doucement l’abattant protégeant les touches d’ivoire noires et blanches sur lesquels mes doigts glissèrent, dans un son de notes dissonantes. La conversation de l’après-midi avec Sandra me revint. Un frisson me parcourut. Pourtant, une seule pensée retint véritablement mon attention.
Il fallait que j’apprenne à jouer du piano. Cela devint, à cet instant, une évidence.
*
Je passai mon premier hiver sur la terre d’Ouessant. La saison tint ses promesses. Vents furieux, vagues dévoreuses, pluies cinglantes. Il ne restait plus grand monde sur l’île, beaucoup s’en étaient retournés sur le continent, notamment les commerçants qui fermaient boutique durant la saison creuse. Ils reviendraient au printemps, juste avant les premiers touristes.
Pas une seule fois, je n’avais regretté d’avoir acheté la maison. Je m’y sentais chez moi comme jamais jusqu’à présent. Je passais de longues heures devant le feu crépitant de la cheminée, tournant les pages des livres que je lisais paisiblement, derrière les fourneaux où je mitonnais les recettes locales que Sandra m’avait fait découvrir. Passionnée de littérature, elle l’était tout autant de cuisine. Elle avait fini par me transmettre le virus, moi qui me contentais, dans ce que je considérais maintenant comme mon ancienne vie, de surgelés et de plats tout prêts. Désormais, je maîtrisais avec fierté la fabrication du fars pod, que j’enrubannais avec dextérité dans un torchon, que je mettais à cuire dans une marmite où mijotait un pot-au-feu. Je me délectais de crustacés, me préparais des tisanes à base d’algues, Sandra m’avait appris à repérer les comestibles. Je les ramassais lors de mes promenades le long de l’océan, là où c’était possible, lorsque qu’il se reposait au loin, offrant ses rocs et ses flancs de sable humide aux habitués qui venaient marcher, ou pêcher, et que je croisais régulièrement.
Et puis, je m’étais mise au piano. La musique perçue le lendemain de mon installation était revenue, avec régularité, dans mes rêves. Elle flottait en permanence en moi. Plus le temps passait, plus j’avais cette impression de l’avoir déjà entendue, quelque part. Ailleurs. Avant. Bien avant de venir ici. J’avais effectué de nombreuses recherches, écouté tout un tas de morceaux de classiques, connus ou moins connus mais aucun ne ressemblait, de près ou de loin à celui qui se jouait la nuit à mes oreilles.
Le printemps fit son apparition. L’air devint un peu plus doux sous les rafales de vent qui étaient, elles, toujours très puissantes. Mais je ne les craignais plus, j’avais appris à les aimer, réalisant combien elles me faisaient me sentir vivante lors de mes promenades le long de l’océan
Puis, mon jardin commença à prendre forme. Les graines et bulbes semées ou plantés quelques semaines auparavant grandissant doucement mais surement, certaines fleurs ouvrirent leurs pétales dans un festival de couleurs.
L’été s’annonçait.
Cela faisait maintenant plus de dix mois que je vivais ici.
Grâce aux leçons que j’avais prises, je me débrouillais plutôt bien au piano, me découvrant même un talent étonnant. Chaque jour, je ne pouvais m’empêcher de m’asseoir devant son beau corps massif de bois pour y jouer quelques notes, parfois des morceaux plus longs. Je tentais aussi, hélas sans succès, de retrouver de mémoire l’air qui visitait mes rêves et dont je n’avais toujours pas découvert la provenance.
Ce matin-là, le ciel était d’un bleu limpide. Chose rare, le vent s’était considérablement calmé. J’ouvris en grand la fenêtre et la porte pour profiter de la douceur du dehors, m’installai sur le large tabouret et soulevai l’abattant. Je mis un long moment avant de me décider. Du dehors, me parvint le joyeux gazouillement des oiseaux.
Il me sembla y entendre une promesse d’éternité.
Mes doigts effleurèrent les touches. Mes yeux se fermèrent d’eux-mêmes, puis, sans comprendre véritablement quelle magie opéra, LA musique s’éleva. Je sus que c’était elle. Celle que j’entendais dans mes rêves. Les notes s’envolèrent, s’éparpillèrent dans toute la maison jusqu’à, peu à peu, s’évanouir. Et le silence résonna de toutes ces notes cristallines qui m’avaient accompagnée la nuit, depuis le jour où je m’étais installée à l’Agapanthe, et que je venais de reproduire.
Je sentis alors une présence dans mon dos. Je me retournai, quelqu’un se tenait sur le seuil de la porte.
L’homme s’excusa, déclara avoir entendu une musique qu’il pensait connaître. Il ne savait pas pourquoi il était entré, sans y avoir été invité. Confus, il s’excusa à nouveau. Ses yeux étaient aussi noirs que les profondeurs secrètes d’un lac mais, tout au fond, dansait pourtant une lumière.
A l’instant où je me levai, tout s’emboîta soudainement, parfaitement, comme un caléidoscope dont l’image se révèle dès lors que toutes les pièces sont correctement assemblées. J’eus la nette sensation d’avoir déjà vécu ce moment. Quelque part, je ne savais où. Et peu m’importait. Car je compris que ma vie se scellait ici, à tout jamais.
